Mouvements au sein des Forces Armées Togolaises Et si c’était le procès Madjoulba ?
Alors que le Tribunal militaire a ouvert depuis lundi 23 octobre 2023, le procès de l’assassinat du Colonel Bitala Madjoulba, ancien commandant du 1er Bataillon d’Intervention Rapide (1er BIR), le Chef de l’Etat Faure Gnassingbé a décidé d’opérer des changements à la tête de certaines unités des Forces armées togolaises (FAT). Ces changements qui interviennent dans un contexte particulier suscitent des questions.
Des changements à la tête des unités stratégiques
Le Régiment Commando de la Garde Présidentielle (RCGP), l’unité qui s’occupe de la sécurité du Chef de l’Etat est désormais dirigé par le Lieutenant-Colonel Aoui.
Ancien chef de corps du régiment commando de la garde présidentielle (RCGP), le Colonel Malibada Gnassingbé a été nommé commandant de la deuxième région militaire du pays.
On notera également que le Colonel Latiémbé Kombate est désormais le commandant supérieur de l’Opération Koundjoare. L’Opération militaire Koundjoaré est un dispositif mis en place depuis septembre 2018 et qui sert de bouclier anti-terroriste entre le Togo et les pays du sahel en proie à l’insécurité, le terrorisme et l’extrémisme violent.
Au titre des nouvelles nominations, le Lt-Col Tchangani Atafaï est nommé Commandant du 2e BIR. Le Lt-Col Atta prend le commandement du 3e Régiment d’infanterie. Lt-Col Mateyedou LABARBORE est aux commandements du Régiment de soutien et d’appui (RSA).
Un contexte particulier
Ces remaniements à la tête de certaines unités hautement stratégiques de l’armée togolaise intervient moins d’un an après le grand chamboulement qui avait fait relever de leurs fonctions l’ancienne ministre de la Défense, Marguerite Gnakade Essossimna et l’ancien Chef d’Etat-Major Général des FAT, le Général Dadja Manganawoé.
Aussi-faut-il rappeler la tenue du procès qualifié par certains observateurs d’historique. En effet, depuis lundi 23 octobre 2023 , l’actualité togolaise est rythmée par l’ouverture du procès du Lieutenant-Colonel Majoulba Bitala, retrouvé mort dans la nuit du 4 au 5 mai 2020. Dans le box des accusés, plusieurs militaires, dont l’ancien Chef de l’Etat-Major des Armées, le Général de Division Abalo Kadhanga. Dans un tel contexte, nombre d’observateurs s’interrogent sur les vraies raisons qui ont motivées ces changements. Surtout que lors du procès en cours certains accusés n’hésitent pas à faire des déballages sur certaines réalités dans l’armée.
Liste des nouvelles nominations
1. Général Kassawa KOLEMAGAH, Inspecteur Général des forces armées (IGEFA)
2. Col Latiémbé Kombate, Commandant Supérieur OPS Koundjoare
3. Col Malibada GNASSINGBE, Commandant de la 2e Région Militaire
4. Lt-Colonel N’Gowaki Kadanga, Commandant du 1er BIR
5. Lt-Col Tchangani Atafaï, Commandant du 2e BIR
6. Lt-Col ATTA, Commandant du 3e Régiment d’Infanterie (3e RI)
7. Lt-Col Mateyedou LABARBORE, Commandant du Régiment de Soutien et d’Appui (RSA)
8. Cdt Djoliba Quindat, Commandant Adjoint Centre nationale d’instruction (CNI)
9. Lt-Col Aoui Commandant du Régiment Commando de la Garde Présidentielle (RCGP)
10. Lt-Col SEHOU, Commandant du Centre d’entraînement aux techniques de tirs opérationnels et de combat (CETTOC) d’Akaba.
Koffi A.

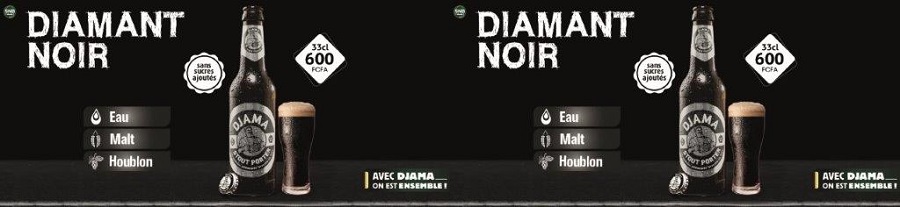

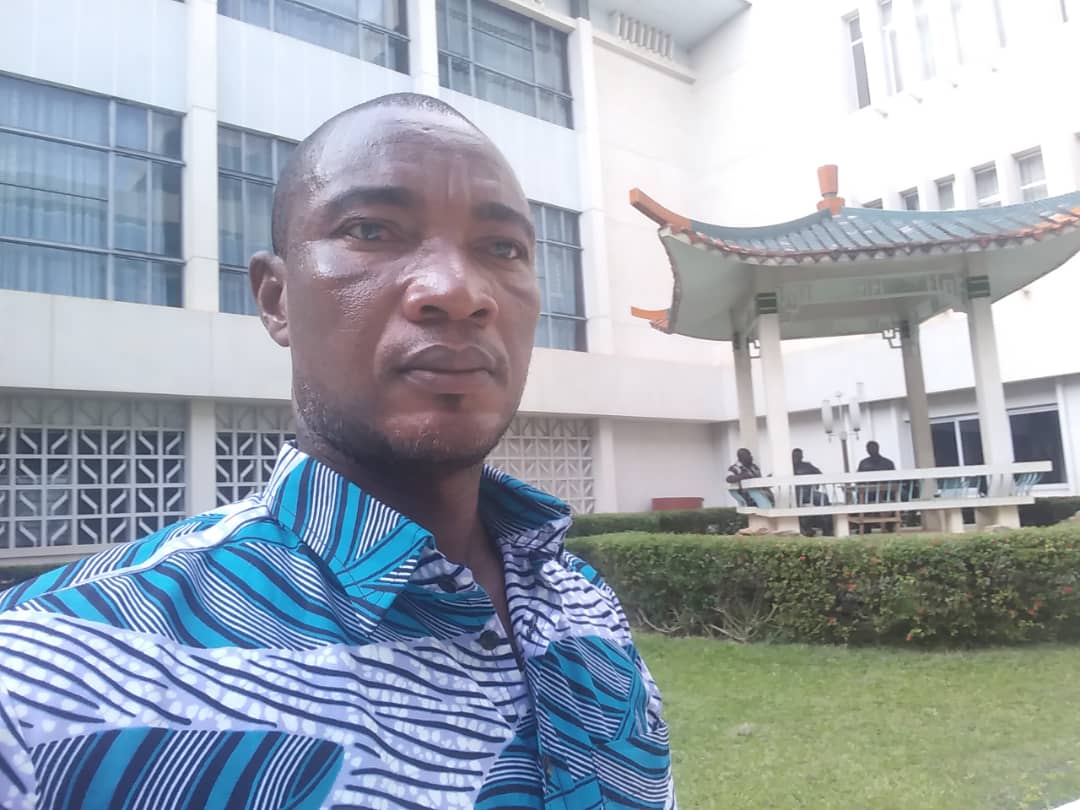
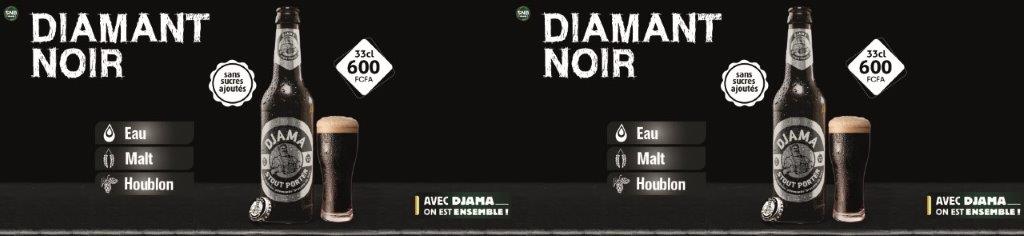


.jpg)
0 Commentaire(s):